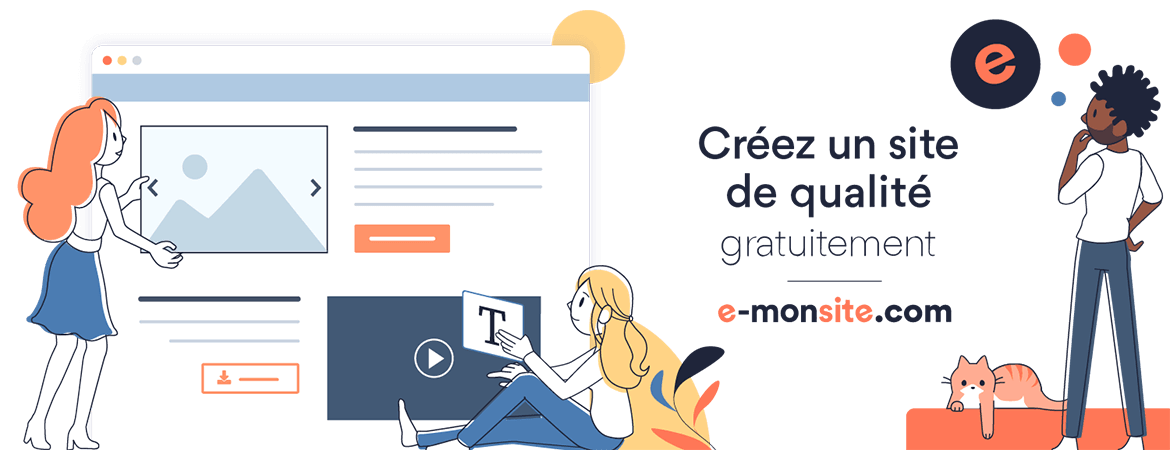THE CONVERSATION: Informationen und mehr.
L’Allemagne, le pays où les hauts fonctionnaires se forment à l’université

Le débat sur la suppression de l’École nationale d’administration est d’autant plus vif qu’il se situe à la convergence de plusieurs enjeux : principes de la méritocratie, ascension sociale, fonctionnement de l’administration publique, réseaux d’influence et rentes professionnelles que procurent les grands corps.
D’autres modèles existent chez nos voisins. Une comparaison avec l’Allemagne éclaire le rôle que peut jouer l’université dans la formation de la haute fonction publique.
Une élite administrative formée à l’université
L’Allemagne sert souvent de modèle à la France, y inclus dans la formation des élites administratives lorsque les fondateurs de l’École libre des sciences politiques s’inspirent de la Prusse pour développer le projet pédagogique de l’ancêtre de Sciences Po en 1871. Pourtant, la formation de l’élite administrative y est bien distincte.
L’Université allemande des sciences administratives de Speyer, fondée seulement deux ans après la création de l’ENA en 1947 par le Gouvernement militaire de la zone française d’occupation sous le nom de « École supérieure d’administration » n’a pas eu une trajectoire comparable à sa cousine française, entre autres du fait de résistances politiques. Elle forme aujourd’hui des juristes qui se destinent à des carrières dans l’administration publique.

La majorité des hauts fonctionnaires allemands passent par les universités du pays. L’accès y est pour la plupart sans sélection et sans droits de scolarité. Ce n’est pas tant la qualité de l’université qui compte, mais le parcours choisi. Les études juridiques sont les plus courantes, ce qui implique de réussir les exigeants examens nationaux de qualification pour les juristes. Il est également très avantageux de finir ses études avec le titre de doctorat, qui confère un statut social bien supérieur qu’en France et qui fait partie de l’état civil de son titulaire. L’importance de ce grade universitaire pour des carrières politiques – et les moyens mis en œuvre pour l’obtenir – ont été sous le feu des projecteurs lors de révélations de cas de plagiats, qui ont coûté leur poste de ministre à plusieurs personnalités.
Des recrutements par ministères et administrations
L’absence d’une formation centralisée reflète la diversité de voies de recrutement. Au niveau fédéral et régional, chaque ministère ou administration recrute par elle-même ses agents, par des modalités ou concours adaptés aux différentes fonctions qu’il s’agit d’exercer. Par conséquent, les carrières des fonctionnaires se déroulent le plus souvent au sein de la fonction publique, avec une mobilité relativement lente et dans un domaine de compétence précis. La dimension fortement juridique des concours explique la prépondérance des juristes parmi les recrutés, mais d’importantes variations peuvent exister.
Les formations spécialisées qui préparent aux carrières dans la fonction publique s’adaptent ensuite à chaque administration et se déclinent au niveau des Länder et au niveau fédéral avec la Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung à Brühl et l’Académie d’Agence fédérale pour l’emploi à Mannheim et Schwerin. Pour la plupart des emplois, l’accès à l’emploi de fonctionnaire passe par une période de stage professionnel (Referendariat) de deux ans, à valider après le diplôme de master.
Il n’est pas rare de commencer sa carrière au niveau régional avant une mobilité au niveau fédéral, mais la compétence technique prime sur la polyvalence dans ce paysage où les ministères qui recrutent sont en charge de la formation – théorique et pratique – de leurs agents sur plusieurs années.
L’investissement public le plus important dans la formation des agents est par ailleurs proposé au sein de l’armée, par deux Bundeswehr-Universitäten à Hambourg et à Munich, dont l’objectif est la formation universitaire des aspirants officiers pour la vie militaire et leur réintégration dans la vie civile après leur service.
Des réseaux partisans
Avec une telle fragmentation, ce que le modèle allemand ne permet pas, c’est de créer une cohésion transversale d’une génération de jeunes fonctionnaires. Mais comme ces réseaux restent précieux pour la vie publique, elles se font au sein des structures partisanes, parmi les militants et dans les fondations proches de chaque parti comme la Konrad Adenauer Stiftung de la CDU ou la Friedrich Ebert Stiftung du SPD.
Ces fondations jouent un rôle d’autant plus central qu’elles proposent des financements d’études qui favorisent la création de réseau pour les lauréats bien après leurs études. Dans la liste de leurs anciens membres se retrouvent les noms des élites économiques, politiques et administratives, des listes bien plus impressionnantes que ceux de chacune des écoles citées plus hautes.
L’engagement politique est ainsi le marqueur des réseaux, plus que les lieux de formations. Il en découle que l’engagement politique est plus stable dans le temps et que les partis politiques servent non seulement à faire de la représentation politique, mais aussi à assurer le maillage entre les territoires et l’élite du pays.
Népotisme, rente et mobilité sociale
Le regard outre-Rhin peut rassurer ceux qui craignent que la France tombe dans le népotisme du début du XXe siècle qui a motivé la création de l’ENA. La sélectivité des concours, à l’exemple du Ministère des affaires étrangères allemand, qui propose une quarantaine de places pour 2 000 candidats chaque année, et la multitude d’étapes, examens et formation pratique que doit passer un candidat avant d’accéder à son emploi et rang préserve des dérives du favoritisme. En absence de corps, il n’y a également pas de rente acquise tôt dans la carrière, comme le procure l’accès aux grands corps en France.
En revanche, le modèle allemand peine autant à lutter contre l’inégalité sociale. Même si les chiffres varient selon les administrations, 40 % des hauts fonctionnaires allemands viennent de parents appartenant à cette même catégorie socio-professionnelle et seul 5 % ont des origines ouvrières, des chiffres largement comparables à la France.
Pour le sociologue Michael Hartmann, la France et l’Espagne avec ses corps d’administration civile, l’Angleterre et la Suisse avec ses universités d’élites ou l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche sans écoles d’élite aboutissent par des chemins très différents au même tableau de reproduction sociale. Seuls les pays scandinaves réussissent à pallier les inégalités sociales au sein de leur système scolaire et universitaire ouverts.
Une lueur d’espoir vient également des chiffres sur l’ascension sociale que permettent des recrutements qui se basent sur une expérience professionnelle déjà acquise. Ainsi, l’accès à une élite professionnelle ou à la haute fonction publique paraît plus ouvert socialement qu’il intervient tard dans une carrière, comme certains procédures de promotion ou de changement de grade. Ceci est vrai même au sein de l’ENA, qui arbore des chiffres bien distincts pour la voie du concours externe et la voie du concours internes, réservée à des fonctionnaires.
A elle toute seule, cette deuxième voie positionnerait l’ENA parmi les grandes écoles les plus ouvertes socialement en France.
La suppression de l’ENA ne sera donc pas la baguette magique pour transformer tous les problèmes de la France. Elle permettra toutefois de réduire le sentiment que l’avenir du pays est dans la main d’un petit groupe de gens auquel l’accès se verrouille avant même que ceux-ci ne commencent l’essentiel de leur expérience professionnelle. Ce sera déjà un grand pas en avant.![]()
Cornelia Woll, professeure titulaire de la FNSP en science politique, Sciences Po – USPC
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
<<1>L’Allemagne, le pays où les hauts fonctionnaires se forment à l’université
Le débat sur la suppression de l’École nationale d’administration est d’autant plus vif qu’il se situe à la convergence de plusieurs enjeux : principes de la méritocratie, ascension sociale, fonctionnement de l’administration publique, réseaux d’influence et rentes professionnelles que procurent les grands corps.
D’autres modèles existent chez nos voisins. Une comparaison avec l’Allemagne éclaire le rôle que peut jouer l’université dans la formation de la haute fonction publique.
Une élite administrative formée à l’université
L’Allemagne sert souvent de modèle à la France, y inclus dans la formation des élites administratives lorsque les fondateurs de l’École libre des sciences politiques s’inspirent de la Prusse pour développer le projet pédagogique de l’ancêtre de Sciences Po en 1871. Pourtant, la formation de l’élite administrative y est bien distincte.
L’Université allemande des sciences administratives de Speyer, fondée seulement deux ans après la création de l’ENA en 1947 par le Gouvernement militaire de la zone française d’occupation sous le nom de « École supérieure d’administration » n’a pas eu une trajectoire comparable à sa cousine française, entre autres du fait de résistances politiques. Elle forme aujourd’hui des juristes qui se destinent à des carrières dans l’administration publique.

La majorité des hauts fonctionnaires allemands passent par les universités du pays. L’accès y est pour la plupart sans sélection et sans droits de scolarité. Ce n’est pas tant la qualité de l’université qui compte, mais le parcours choisi. Les études juridiques sont les plus courantes, ce qui implique de réussir les exigeants examens nationaux de qualification pour les juristes. Il est également très avantageux de finir ses études avec le titre de doctorat, qui confère un statut social bien supérieur qu’en France et qui fait partie de l’état civil de son titulaire. L’importance de ce grade universitaire pour des carrières politiques – et les moyens mis en œuvre pour l’obtenir – ont été sous le feu des projecteurs lors de révélations de cas de plagiats, qui ont coûté leur poste de ministre à plusieurs personnalités.
Des recrutements par ministères et administrations
L’absence d’une formation centralisée reflète la diversité de voies de recrutement. Au niveau fédéral et régional, chaque ministère ou administration recrute par elle-même ses agents, par des modalités ou concours adaptés aux différentes fonctions qu’il s’agit d’exercer. Par conséquent, les carrières des fonctionnaires se déroulent le plus souvent au sein de la fonction publique, avec une mobilité relativement lente et dans un domaine de compétence précis. La dimension fortement juridique des concours explique la prépondérance des juristes parmi les recrutés, mais d’importantes variations peuvent exister.
Les formations spécialisées qui préparent aux carrières dans la fonction publique s’adaptent ensuite à chaque administration et se déclinent au niveau des Länder et au niveau fédéral avec la Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung à Brühl et l’Académie d’Agence fédérale pour l’emploi à Mannheim et Schwerin. Pour la plupart des emplois, l’accès à l’emploi de fonctionnaire passe par une période de stage professionnel (Referendariat) de deux ans, à valider après le diplôme de master.
Il n’est pas rare de commencer sa carrière au niveau régional avant une mobilité au niveau fédéral, mais la compétence technique prime sur la polyvalence dans ce paysage où les ministères qui recrutent sont en charge de la formation – théorique et pratique – de leurs agents sur plusieurs années.
L’investissement public le plus important dans la formation des agents est par ailleurs proposé au sein de l’armée, par deux Bundeswehr-Universitäten à Hambourg et à Munich, dont l’objectif est la formation universitaire des aspirants officiers pour la vie militaire et leur réintégration dans la vie civile après leur service.
Des réseaux partisans
Avec une telle fragmentation, ce que le modèle allemand ne permet pas, c’est de créer une cohésion transversale d’une génération de jeunes fonctionnaires. Mais comme ces réseaux restent précieux pour la vie publique, elles se font au sein des structures partisanes, parmi les militants et dans les fondations proches de chaque parti comme la Konrad Adenauer Stiftung de la CDU ou la Friedrich Ebert Stiftung du SPD.
Ces fondations jouent un rôle d’autant plus central qu’elles proposent des financements d’études qui favorisent la création de réseau pour les lauréats bien après leurs études. Dans la liste de leurs anciens membres se retrouvent les noms des élites économiques, politiques et administratives, des listes bien plus impressionnantes que ceux de chacune des écoles citées plus hautes.
L’engagement politique est ainsi le marqueur des réseaux, plus que les lieux de formations. Il en découle que l’engagement politique est plus stable dans le temps et que les partis politiques servent non seulement à faire de la représentation politique, mais aussi à assurer le maillage entre les territoires et l’élite du pays.
Népotisme, rente et mobilité sociale
Le regard outre-Rhin peut rassurer ceux qui craignent que la France tombe dans le népotisme du début du XXe siècle qui a motivé la création de l’ENA. La sélectivité des concours, à l’exemple du Ministère des affaires étrangères allemand, qui propose une quarantaine de places pour 2 000 candidats chaque année, et la multitude d’étapes, examens et formation pratique que doit passer un candidat avant d’accéder à son emploi et rang préserve des dérives du favoritisme. En absence de corps, il n’y a également pas de rente acquise tôt dans la carrière, comme le procure l’accès aux grands corps en France.
En revanche, le modèle allemand peine autant à lutter contre l’inégalité sociale. Même si les chiffres varient selon les administrations, 40 % des hauts fonctionnaires allemands viennent de parents appartenant à cette même catégorie socio-professionnelle et seul 5 % ont des origines ouvrières, des chiffres largement comparables à la France.
Pour le sociologue Michael Hartmann, la France et l’Espagne avec ses corps d’administration civile, l’Angleterre et la Suisse avec ses universités d’élites ou l’Allemagne, l’Italie et l’Autriche sans écoles d’élite aboutissent par des chemins très différents au même tableau de reproduction sociale. Seuls les pays scandinaves réussissent à pallier les inégalités sociales au sein de leur système scolaire et universitaire ouverts.
Une lueur d’espoir vient également des chiffres sur l’ascension sociale que permettent des recrutements qui se basent sur une expérience professionnelle déjà acquise. Ainsi, l’accès à une élite professionnelle ou à la haute fonction publique paraît plus ouvert socialement qu’il intervient tard dans une carrière, comme certains procédures de promotion ou de changement de grade. Ceci est vrai même au sein de l’ENA, qui arbore des chiffres bien distincts pour la voie du concours externe et la voie du concours internes, réservée à des fonctionnaires.
A elle toute seule, cette deuxième voie positionnerait l’ENA parmi les grandes écoles les plus ouvertes socialement en France.
La suppression de l’ENA ne sera donc pas la baguette magique pour transformer tous les problèmes de la France. Elle permettra toutefois de réduire le sentiment que l’avenir du pays est dans la main d’un petit groupe de gens auquel l’accès se verrouille avant même que ceux-ci ne commencent l’essentiel de leur expérience professionnelle. Ce sera déjà un grand pas en avant.![]()
Cornelia Woll, professeure titulaire de la FNSP en science politique, Sciences Po – USPC
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
Rassismus bleibt ein ständiges Problem. Bleiben wir wachsam. Wie kann man gegen Rassimus angehen? KANT! Was ist Aufklärung?Politiques identitaires et mythe du « grand remplacement »

Dans un tome récemment paru des Cahiers noirs, Heidegger se réclamait de la métapolitique qui doit selon lui remplacer la philosophie (Gesamtausgabe, t. 94, 2014, p. 115). La métapolitique connaît aussi un regain d’intérêt dans une certaine gauche radicale (voir par exemple Alain Badiou, Abrégé de métapolique, Paris Seuil, 1998).
La métapolitique séduit largement, car elle subordonne la politique à un mythe ou à une théologie qui transcende les contingences historiques. Qu’il soit nationaliste, ethnique ou racial, l’irruption de ce mythe dans l’histoire s’accomplit dans un bain de sang, comme l’a souligné en 1945 Ernst Cassirer dans Le mythe de l’État.
Par exemple, le plan général des nazis pour l’Est (Generalplan Ost), affirmait que les Allemands « de souche » avaient été remplacés par les juifs et les Slaves, et qu’il fallait donc exterminer les juifs, déporter les Slaves et établir à nouveau des paysans allemands dans les territoires ainsi libérés, de la Baltique à la Crimée.
La purification raciale fut d’abord le but explicite des Lois de Nuremberg promulguées en 1935, élaborées sous la responsabilité d’une commission dirigée par Hans Frank et dont Heidegger était membre. Pour protéger le peuple allemand et sa « santé héréditaire », les nazis justifiaient les massacres par la nécessité d’un eugénisme actif, tant racial que culturel, tant biologique que spirituel. En effet, selon eux, l’identité d’un peuple peut être détruite par son adultération génétique comme par une invasion qui le prive du territoire où il est enraciné. L’image horrifique de l’étranger violeur synthétise encore ces deux périls.
Références et maîtres à penser
Pour les identitaires, le mythe nazi demeure une source d’inspiration, revendiquée plus ou moins ouvertement selon les publics et les situations. En 1983, le groupe terroriste The Order forgea le slogan des « 14 mots », adapté ainsi en français : « Nous devons assurer l’existence de notre race et un futur pour les enfants blancs », slogan notamment repris en avril 2019 par l’attaquant d’une synagogue près de San Diego et par Brenton Tarrant, auteur du massacre dans les mosquées de Christchurch.
Quand en 2013 le militant néonazi Dominique Venner se suicida spectaculairement dans Notre-Dame de Paris, il laissa en ligne un ultime post consacré à… Heidegger ; et Radio Courtoisie diffusa le lendemain une lettre où il écrivait : « Je m’insurge aussi contre le crime visant au remplacement de nos populations ». Peu après, Marine Le Pen, rendait ainsi hommage à ce militant : « Respect à Dominique Venner, dont le dernier geste, éminemment politique, aura été de tenter de réveiller le peuple français ».
En février 2015, Martin Sellner, fondateur et dirigeant du Mouvement identitaire autrichien (Identitäre Bewegung Österreichs), à l’aile droite du FPÖ, publiait dans la revue d’extrême droite Sezession, un article intitulé « Mon chemin de pensée vers Heidegger ». Il y loue sa « métapolitique », et se réfère à Guillaume Faye, le négationniste fondateur des Annales d’histoire révisionniste, où Faurisson publia les lettres de soutien qu’il avait reçues de Jean Beaufret, principal initiateur de l’école heideggérienne en France.
Nouveau Saint Paul, Sellner évoque aussi son « chemin de Damas » avec Heidegger (p. 8). Dans le même numéro spécial Heidegger, Sellner voisine avec Ernst Nolte, historien révisionniste élève du Maître et fondateur reconnu de l’école révisionniste allemande. Par ailleurs, Sellner se réfère aussi à Dominique Venner, Alain de Benoist et Alexander Douguine, eurasiste radical, auteur de plusieurs livres à la gloire de Heidegger, et qui demandait récemment l’extermination des Ukrainiens.
Proche de l’extrême droite allemande, inspiré par Génération identitaire en France et CasaPound en Italie, Sellner a d’abord multiplié les pèlerinages sur les tombes de la Wehrmacht. Son mouvement s’est fait connaître par des profanations de bâtiments religieux accueillant des réfugiés, des attentats contre les permanences du parti socialiste SPD, dont la tiédeur sociale-démocrate ne semblait pas appeler de telles violences, et des actions commando contre l’Université et le Burgtheater de Vienne pour empêcher la représentation d’un spectacle d’Elfriede Jelinek, coupable non seulement d’être prix Nobel, antinazi et de père juif, mais de mettre en scène des réfugiés. L’attaque du théâtre fut alors présentée comme « pacifique » (friedlich) par Heinz-Christian Strache, dirigeant du FPÖ et alors en passe de devenir vice-chancelier.
Or, après le meurtre de masse (51 victimes) commis à Christchurch par Brenton Tarrant, on apprit que ce terroriste néonazi s’était rendu en Autriche en 2017, entretenait avec Sellner une correspondance militante, échangeait avec lui des invitations amicales et avait même financé son mouvement. Comme lui, il est vrai, Sellner propage la thèse de la substitution des populations (Bevölkerungsaustausch), engageant les blancs à une lutte pour la vie. Son mouvement dissous et sous la menace d’un procès, Sellner prodigue à présent des menaces voilées, déclarant par exemple : « Si l’on ne nous écoute pas, la société sera de plus en plus radicalisée. Je ne me sentirai pas du tout responsable si une fusillade avait lieu en Autriche » (Le Monde II, 18 mai 2019).
En France aussi
Bien entendu, la France n’est pas absente de l’internationale néo-nazie. Brenton Tarrant a intitulé Le grand remplacement (The Great Replacement) le texte de 74 pages qu’il a mis en ligne avant de commettre son crime et qui finit par cet adieu au lecteur : « Je vous verrai au Valhalla ». L’éditeur véloce de la traduction française présente ainsi l’auteur : « Celui-ci explique ici les raisons de son passage à l’acte en invoquant notamment les thèses françaises de Renaud Camus à propos du “grand remplacement” ou encore du “génocide blanc”. L’influence de la situation française est au cœur de son œuvre, notamment dans son analyse de la politique et des rapports avec les musulmans en France ».
Lors de son voyage en Europe, Tarrant avait été catastrophé par la victoire du « mondialiste » Macron contre Marine Le Pen. Elle milite en effet contre le grand remplacement, bien qu’elle s’en défende à l’occasion. En 2011, elle questionnait : « Comment pourrions-nous nous satisfaire de voir nos adversaires poursuivre leur œuvre de ruine morale et économique du pays, de le livrer à la submersion par un remplacement organisé de notre population ? ». En septembre 2018, dans un meeting à Fréjus, elle répétait : « Jamais dans l’histoire des hommes, nous n’avons vu de société qui organise ainsi une submersion irréversible et d’une ampleur non-maîtrisable qui, à terme, fera disparaître, par dilution ou substitution, sa culture et son mode de vie. ».
À lire aussi : Qui a peur du métissage ?
Par solidarité avec l’extrême droite française, Brenton Tarrant a également financé Génération identitaire, le mouvement de jeunesse du parti Les identitaires (ancien Bloc identitaire), ce que son porte-parole, Romain Espino, a fini par reconnaître.
Comme avant lui Anders Breivik qu’il a pris pour modèle, Brenton Tarrant a puisé dans la symbolique nazie, ornant par exemple ses armes et son manifeste d’une roue runique, ou « Soleil noir », signe ésotérique de l’Allemagne secrète qui orne au château SS de Wewelsburg la salle d’apparat des Obergruppenführer. Mais il a prodigué d’autres signes de reconnaissance : quand il a diffusé en direct son massacre sur Facebook live, il a fait le signe des suprématistes blancs : le pouce et l’index arrondis ensemble pour dessiner un P, les trois autres doigts levés, pour dessiner un W, soient les initiales de white power.
Quelques semaines après, en Estonie, le néonazi Ruuben Kaalep, élu du parti EKRE, membre de la coalition au pouvoir, recevait Marine Le Pen et diffusait un selfie où tous deux font ce même signe suprématiste. Le 15 mai, sur France Inter, Marine Le Pen se disculpait toutefois en interprétant ce signe comme le OK des « plongeurs de combat », et en précisant que son hôte n’était pas un « suprématiste blanc », mais un « suprématiste finno-ougrien », nuance euphémique que le lecteur appréciera pleinement.
François Rastier a récemment publié « Heidegger, Messie antisémite. Ce que révèlent les Cahiers noirs » (Le bord de l’eau, 2018) et « Faire sens. De la cognition à la culture », Garnier Classiques, 2018).![]()
François Rastier, Directeur de recherche, Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
Ajouter un commentaire